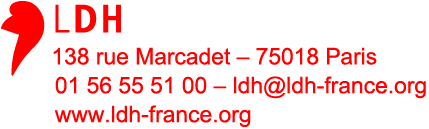Tribune de Nathalie Tehio, présidente de la LDH
Lire la tribune sur Mediapart
Depuis des années la guerre est partout et sert à nous mobiliser, nous faire peur ou nous discipliner de force. Guerre contre le terrorisme, bataille de l’emploi, guerre contre le Covid, guerre contre le narcotrafic, rien n’échappe à cette dérive langagière qui inquiète tant elle a déjà été surexploitée par le fascisme d’avant-guerre, de la « bataille du blé » à la « guerre au paludisme ». Cette rhétorique permet également au président de la République de se poser en chef de guerre.
Malgré tout, la guerre est bien redevenue une réalité européenne depuis l’agression de l’Ukraine par la Russie en 2022. Pour la LDH (Ligue des droits de l’Homme), c’est d’abord une question d’effectivité du droit international dans un monde où l’emploi de la force et le déni du droit progressent. Avec la guerre, ressurgissent dans les milieux progressistes les débats ayant secoué l’Europe d’entre-deux-guerres entre pacifisme intégral et promotion d’un droit de se défendre. La LDH renoue alors avec les positions qui furent les siennes au profit des républicains espagnols durant la guerre d’Espagne. Elle promeut le droit du peuple ukrainien à effectivement se défendre et insiste sur la nécessité pour les démocraties de lui donner les moyens de pérenniser sa résistance. Elle revendique un cessez-le-feu mais conjointement avec le retrait inconditionnel des troupes russes du territoire ukrainien, puisque le droit international exige le respect de l’intégrité territoriale d’un Etat.
Parallèlement, il est important que les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) contre des responsables russes soient mis en œuvre. La question des enfants ukrainiens enlevés par la Russie doit être rapidement traitée : c’est un cas potentiel de génocide qui devra être jugé. De ce fait, il faut aussi soutenir les opposants russes à la guerre en Ukraine afin de les protéger de la violence de la répression par les autorités russes. Celles-ci interdisent non seulement toute dissidence mais aussi toute possibilité de défense des droits de l’Homme : après Amnesty International, elles viennent de déclarer « indésirable en Russie » la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), dont la LDH est membre.
Mais la guerre n’a pas seulement fait son retour sur notre continent, elle a immédiatement fait son apparition dans les discours de politique intérieure d’Emmanuel Macron et de ses gouvernements. Argument massue visant à tuer le débat démocratique, elle sert depuis près de quatre ans maintenant à justifier des dépenses de défense exorbitantes, une course aux armements, les politiques économiques libérales et la militarisation de notre jeunesse.
Dans un contexte de balkanisation du champ politique, et alors qu’Emmanuel Macron ne dispose pas de majorité à l’Assemblée nationale, il est logique qu’il ait fortement investi l’un des seuls terrains où un accord transpartisan majoritaire est possible : la défense. Il s’agit en effet d’un domaine d’accord entre la gauche socialiste, la droite et l’extrême droite. Il est dès lors tentant de vouloir faire converger, autour d’une menace russe, des hausses de dépenses militaires que nul n’ose ou ne veut contester et d’en faire une base apparente de consensus. Les lois de programmation militaire (LPM) et autres débats sur la sécurité donnent lieu à des votes massifs restaurant à moindre coût politique l’apparence de majorité du bloc central.
Depuis le début du conflit sur le sol ukrainien, nos désormais anciens ministres des finances, Bruno Lemaire, et des armées, Sébastien Lecornu, se sont fait les chantres de l’« économie de guerre ». La LPM votée par le Parlement en 2023 permet d’organiser un vaste soutien à l’industrie d’armement pour lui permettre de fournir à l’Ukraine ce que l’industrie française peut produire et pour préparer la France à une guerre de haute intensité. Il fallait de ce fait multiplier les commandes publiques pour que l’industrie privée, issue de la privatisation des arsenaux d’Etat dans les années 80 et 90, recrée des chaînes de production et rattrape un certain retard technologique dans des domaines-clefs des conflits actuels (drones, missiles moyenne et longue portée…). Cette loi montre que pour approvisionner actuellement l’Ukraine, la France est contrainte d’organiser des transferts massifs d’argent public au profit de sociétés privées pour les vingt prochaines années. Cela engage le futur. On peut aussi interroger la pertinence de cette privatisation, étant donné la faiblesse de l’adaptabilité du secteur[1]. L’industrie d’Etat était également planifiée mais était plus flexible et moins coûteuse : cette question devrait également être tranchée par un débat démocratique et transparent.
Cette « guerre » permet ainsi de faire passer une politique néolibérale et d’accélérer les coupes budgétaires pour les services publics et les prestations sociales. Tous les partis d’accord avec la priorité de défense définie dans la LPM sont invités à soutenir la chasse aux « dépenses inutiles » et un appui aux « sacrifices nécessaires » qui permettront dans un contexte contraint d’« assurer la sécurité des Français ». La défense devient alors la caution des coupes dans les budgets d’éducation, sociaux ou culturels pour faire face à ce qui est présenté comme une menace russe existentielle et rapprochée.
Il ne s’agit pas de nier le caractère déstabilisant de la politique extérieure de la Russie, son absence de respect du droit international. Pas plus que l’Ukraine, la République française ne peut se passer d’avoir les moyens de se défendre. Mais il est possible de discuter de l’intensité de la menace russe : comment un pays qui après son entrée en Ukraine en 2022 n’a pas avancé de plus de quelques milliers de kilomètres carrés pourrait dans les toutes prochaines années (2030 étant souvent évoqué) être prêt à envahir l’Europe comme le proclame notre chef d’état-major des armées[2] ?
L’Europe doit certes pouvoir décourager tout velléité d’agression russe et elle doit désormais le faire sans l’allié états-unien. Mais cela ne nécessite pas, au nom du « Rearm Europe », de doubler son budget ou la taille de son armée qui est déjà à parité avec la Russie tout en possédant une supériorité technologique et industrielle certaine. Ne doit-on plutôt bénéficier d’un débat public argumenté sur des décisions de nature politique, comme l’intérêt de mettre en place les commandements communs en Europe que l’Otan ne garantit plus, ou de se répartir les productions et les tâches militaires pour davantage d’efficacité ?
On comprend que le point de vue de la Pologne ou des pays baltes soit différent de celui de l’Italie ou de l’Espagne. C’est aussi pourquoi il y a urgence à entendre ces différentes voix, à avoir accès à des expertises diverses pour construire les conditions d’un débat démocratique.
En annonçant la préparation au conflit direct avec la Russie comme l’alpha et l’oméga d’une vision européenne du temps qui vient, celle-ci n’a d’autre choix que de s’y préparer également, alors que son état après le conflit en Ukraine pourrait ouvrir le chemin à d’autres futurs. Dans une telle spirale, tout incident risque de déclencher inexorablement le conflit. Il est pourtant nécessaire de construire les conditions du non-affrontement avec l’énergie et la volonté que la raison impose.
Et qu’en est-il d’un contrôle démocratique sur l’institution militaire européenne qui émergerait de ce programme ? Sur l’armement ? La question est légitime puisque la loi (LPM) de 2023 a créé une commission parlementaire d’évaluation de la politique du gouvernement d’exportation de matériels de guerre[3], qui s’est constituée en janvier 2025 et ne s’est réunie qu’une fois sans publier aucune information[4]. Et ce, en dépit d’accusations d’exportations d’armes par des sociétés françaises, ou au moins de composants employés à Gaza, avec constitution de partie civile de la LDH pour complicité de crime de guerre et génocide[5].
Sur le plan économique, il faut bien constater que les seules actions attribuées à la Russie visent à fragiliser notre société en insistant sur ses lignes de fracture interne. Nous avons donc davantage besoin de développer l’éducation pour éviter la propagande et du social pour assurer la cohésion et donc la résilience de notre société, que de faire des coupes budgétaires pour avoir plus de chars. Si on veut lutter contre la désinformation, il faut surtout développer enfin des médias libres, indépendants tant de l’Etat que des grandes fortunes, dont certaines sont fondamentalement liées à la nouvelle économie de guerre. Enfin, il s’agit d’apaiser les tensions, en œuvrant à un développement économique profitant à tous. L’effet multiplicateur de la dépense militaire vendue par le chef d’état-major des armées existe, mais n’est pas relié spécialement à la défense, puisque Keynes expliquait au siècle dernier que cet effet découlait du principe même de la dépense publique, que ce soit pour des infrastructures d’éducation ou de transport… bref en faveur d’une économie au service de tous.
De surcroît, cette guerre qu’on nous annonce prochaine permet de mettre sur les rails un service militaire, et de « discipliner », « mettre au pas » une part de la jeunesse considérée rebelle. Il existait déjà les classes de défense, mais le ministère de l’Education nationale vient de publier un guide « Acculturer les jeunes à la défense », demandant aux enseignants d’inculquer aux élèves la culture militaire !
Et du feu service national universel (SNU) au service militaire « volontaire », ce climat prépare quasi inexorablement à un service militaire obligatoire dont la mise en place serait soutenue par ceux de la population qui, compte tenu de leur âge, sont sûrs de ne pas le faire.
La question de la conscription mérite d’être posée mais calmement, dans le cadre d’un débat démocratique transparent et non pas dans une peur suscitée et une urgence proclamée. Une partie de la gauche, depuis Jaurès, soutient la conscription pour mettre en place une armée démocratique, héritière de celle de l’an II, et pour briser la caste des soldats professionnels bellicistes. Mais ce ne peut pas être un projet d’imposition de l’ordre et de la discipline à une jeunesse qui mérite mieux que d’être « formatée » par des cadres militaires. On ne forme pas des citoyens en leur apprenant à se taire et à ne pas réfléchir.
Il s’agit alors également de s’interroger sur la pertinence de la professionnalisation de nos armées, qui a produit une armée expéditionnaire, sans conscience politique ni recul sur les opérations extérieures menées, extrêmement liée à la fonction présidentielle via notamment l’état-major particulier de celui-ci[6]. Est-il sain finalement de couper de la société 300 000 hommes et femmes et de les former au maniement des armes sans liberté associative, syndicale, d’expression, sans lien courant avec notre société du fait de leur encasernement dans la France périphérique et d’un rythme d’opération qui les maintiennent en vase clos ?
Enfin si cela a lieu, il faut se souvenir de ce qu’était le service national en termes de libertés : restriction de l’accès à certains médias, mauvais traitements, rémunération très faible, absence de droits associatifs et syndicaux, absence de cadre de dialogue et de concertation. La LDH avait d’ailleurs créé un « comité droits et libertés dans l’institution militaire » travaillant notamment sur ces sujets. Là encore peut-on souhaiter une telle expérience, magnifiée par l’Etat, pour commencer sa vie professionnelle ?
La guerre est bien de retour en Europe avec l’invasion de l’Ukraine, et nous souhaitons apporter tout notre soutien au peuple ukrainien qui lutte pour sa liberté. Mais cette triste guerre ne doit pas servir de prétexte pour enrichir les marchands de canon, accélérer la destruction de nos services publics ou discipliner et dépolitiser notre jeunesse.
Enfin, il faut absolument que la situation actuelle permette de prendre conscience que la « loi du plus fort » promue par l’extrême droite, de Poutine à Trump et à Netanyahou, déstabilise le monde, favorise les conflits armés, et détruit l’Etat de droit.
Nathalie Tehio, présidente de la LDH
[1] Et par ailleurs la transformation du ministre des Affaires étrangères en représentant de commerce…
[2] Par ailleurs, ancien chef d’état-major particulier de l’Elysée, c’est-à-dire principal conseiller militaire de la présidence.
[3] Voir la lettre ouverte envoyée par la LDH, la FIDH et l’observatoire de l’armement aux parlementaires à propos de cette commission.