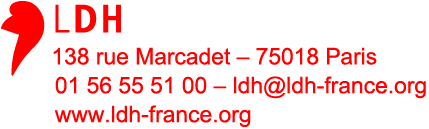Tribune de Nathalie Tehio, présidente de la LDH
Cette nouvelle année arrive dans un contexte de visées prédatrices par l’internationale de l’extrême droite telles que nous pourrions rester dans la sidération. Bien au contraire, après l’agression de l’Ukraine par Poutine, ou le génocide à Gaza par Netanyahou, les attaques du président des Etats-Unis contre le droit international, contre toute contrainte juridique même, en imposant la toute-puissance de la force, peuvent rendre palpable le risque touchant tout un chacun de perdre nos libertés et même la vie.
Dans un contexte français d’élections municipales, l’enjeu essentiel est de faire reculer l’extrême droite. Celle-ci n’est pas présente au
Sénat pour l’instant. Il importe de ne pas lui offrir ce pouvoir pour ne pas faciliter le vote de son programme de préférence nationale, autrement dit de lois discriminatoires. En septembre prochain, une grande partie des 348 sièges du Sénat sera renouvelée, au suffrage indirect par le biais d’un collège d’élus locaux, essentiellement des conseillers municipaux. Ainsi les prochaines élections municipales auront aussi un effet sur celles du Sénat, pour les renouvellements du Sénat en 2026 et 2029.
A force de voir reculer nos droits et libertés depuis plus de vingt ans maintenant, beaucoup ont l’impression que l’autoritarisme est déjà là, et que l’extrême droite au pouvoir n’y changerait rien. Face à un sentiment de désespoir politique, il est nécessaire de distinguer la montée de l’illibéralisme de l’installation d’un autoritarisme brutal, et donc de ne pas faciliter par passivité une arrivée au pouvoir dans une prophétie autoréalisatrice.
Il est certain que plus les libertés sont atteintes, et plus le risque de mise en place d’un pouvoir dictatorial s’accroît. Les citoyens s’accoutument à la perte de liberté et n’offrent plus la même résistance à la surveillance généralisée ou à l’arbitraire. Les outils de l’Etat sont en place et offrent un champ d’intervention déjà très important aux gouvernants. Mais selon le parti au pouvoir, leur usage sera plus ou moins impactant.
Le régime installé par la Constitution de 1958, et singulièrement sa pratique macronienne d’exploitation de chaque possibilité d’élargir ses prérogatives (y compris sans support textuel), n’en font pas une dictature. Les atteintes, certes de plus en plus graves, aux droits et libertés ne changent pas la nature d’un régime. Pour l’heure, elles restent limitées en nombre, dans le temps et dans l’espace et surtout des juges assez indépendants[1] peuvent se fonder sur des principes supra-légaux pour annuler les textes les plus liberticides. Même les démocraties dépassent les normes du droit et de la raison, et ce n’est pas notre association, créée il y a 128 ans pour faire face à la raison d’État et à la négation des droits de la défense, qui dira le contraire. Mais si nous perdons la capacité à faire appel au juge ou si celui-ci devient complètement instrumentalisé par le pouvoir ou ne peut plus appliquer les textes proclamant les droits de l’Homme, alors les attaques sur les libertés ne rencontreront plus aucun frein et la question de la nature du régime sera posée.
En réalité, si l’on observe la montée des totalitarismes dans les années 1920 et 1930 ou ce qui est en train de se jouer dans certaines parties du monde aujourd’hui, il s’agit d’une question d’intensité dans ces attaques et d’outils pour y répondre. Le pouvoir autoritaire, dont nous craignons la mise en place dans les années qui viennent avec l’extrême droite, use partout des mêmes moyens : attaques contre l’Etat de droit et de la chose jugée, arrestations arbitraires, muselage des médias et des associations, interdiction des manifestations…– mais il le fait de façon massive, quotidienne et surtout sans plus aucun contrôle. C’est cette saturation de l’espace public par un Etat sans limites ni principes qui caractérise le véritable danger mortel pour nos démocraties. Perdre de vue la différence non de nature mais d’intensité, c’est prendre le risque de banaliser l’autoritarisme et de ne plus pouvoir mobiliser contre lui. Le fascisme n’est pas encore là, mais il approche et il faut le faire savoir.
Cela dit, il faut rester mobilisés face aux dérives illibérales d’une partie du personnel politique français, car leur accoutumance à une forme d’autoritarisme les conduit à perdre le sens de la limite et à s’allier avec l’extrême droite. C’est ce qui s’est passé en Allemagne dans les années 1930, où la droite a donné le pouvoir aux nazis, pensant naïvement le partager et les contrôler. Si l’histoire nous apprend une chose, c’est que les partis autoritaires ne partagent jamais le pouvoir longtemps et font toujours payer ceux qui ont tenté de les limiter ou de les contraindre. Il convient de le rappeler à ceux qui font des alliances pour les municipales, ou à ceux qui sont tentés de voter pour certains candidats indépendants, en réalité des faux-nez de l’extrême droite.
Si les atteintes aux droits et libertés nous inquiètent et doivent en 2026, comme en 2025, nous mobiliser, il est certain que notre plus grande inquiétude est qu’une partie de nos responsables politiques, pour sauver un fauteuil de maire ou une carrière, cèdent à la pression médiatique des milliardaires rêvant d’une union des droites qui ne serait que la victoire de l’autoritarisme le plus débridé. S’il y a une frontière entre membres du parti les Républicains prônant une politique sécuritaire à surveiller et extrémistes à combattre, elle se situe évidemment là, dans le maintien d’un cordon sanitaire autour des ennemis de la démocratie et de la République. Les élections municipales qui viennent seront donc un jalon important pour déterminer qui est désormais un ennemi de la République et qui a perdu toute légitimité pour l’incarner.
Aussi devons-nous nous souhaiter une bonne année, car notre combat est plus que jamais nécessaire, et unis, nous pouvons déjouer les pronostics : nous l’avons déjà fait en 2024 !
Nathalie Tehio, présidente de la LDH